Méthode d'obtention :
Le castoréum résulte de l'extraction d'une sécrétion située dans une poche du castor américain ou européen, située proche de son anus. Le castor se sert de cette sécrétion, en combinaison avec son urine, pour marquer son territoire et s'enduire d'une couche imperméable pour plonger dans l'eau. Cette poche est à la fois présente chez le mâle et la femelle. Le castor doit être tué pour pouvoir récupérer la poche de sécrétion.
Le résinoïde résulte du séchage durant une à deux années, du broyage puis de la teinture des poches dans l'alcool. Cette teinture est généralement effectuée en mélangeant environ 20 parts massiques d'alcool par rapport à la masse des poches. Une petite quantité de potasse peut être ajoutée pour favoriser l'extraction. Le rendement global de l'extraction est relativement élevé, tant 45 à 75% la résine de castoréum est soluble dans l'alcool.
Parfois, le séchage des poches est effectué grâce à la fumée d'un feu de bois. Une telle pratique donne une odeur plus fumée et violente à l'extrait, le rapprochant de la note du goudron de bouleau.
Le résinoïde de castoréum peut faire l'objet d'une distillation pour en retirer la couleur. Cette distillation n'a pas de grand impact olfactif.
Influence et répartition des chémotypes :
Le castoreum de Sibérie est réputé pour être de meilleure qualité que celui du Canada.
Médecine alternative :
Les informations délivrées ci-dessous sont issues d'ouvrages de référence en aromathérapie. Données à titre informatif, elles ne sauraient en aucun cas constituer une information médicale, ni engager la responsabilité de ScenTree.
Autrefois, la résine de castoréum pouvait être utilisée pour soigner des maux d'oreille, de tête, une sciatique ou des crises d'épilepsie. Au XVIIIème siècle, le castoréum servait aussi à traiter les maladies cérébrales, les vertiges et les crampes à l'estomac.

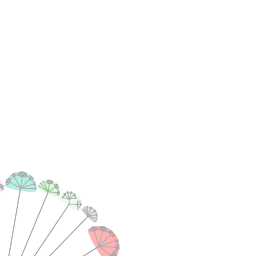


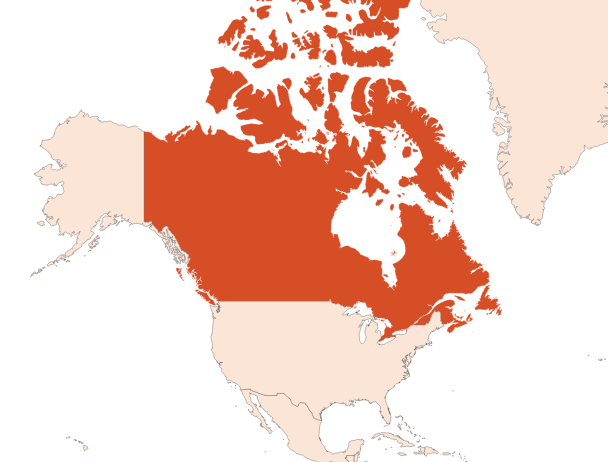
Commentaires :